
- Accueil - programme - les artistes - les oeuvres - tarifs - amateurs - réservations - accès - Réservations - Historique - Le lieu - Accès - Contact
EDITION 2010 : les oeuvres
Cliquer sur le nom de l'oeuvre pour accèder aux commentaires :
- F. CHOPIN : Les Ballades
- F. CHOPIN : Ballade n°1 en sol mineur, Op. 23.
- F. CHOPIN : Ballade n°2 en fa majeur, Op. 38
- F. CHOPIN : Ballade n°3 en la bémol majeur, Op. 47
- F. CHOPIN : Ballade n°4 en fa mineur, Op. 52
- F. CHOPIN : Polonaise Héroïque en la bémol majeur, Op. 53
- F. CHOPIN : Trio Op. 8 en sol mineur
- A. PIAZZOLLA : Les Quatres Saisons de Buenos Aires
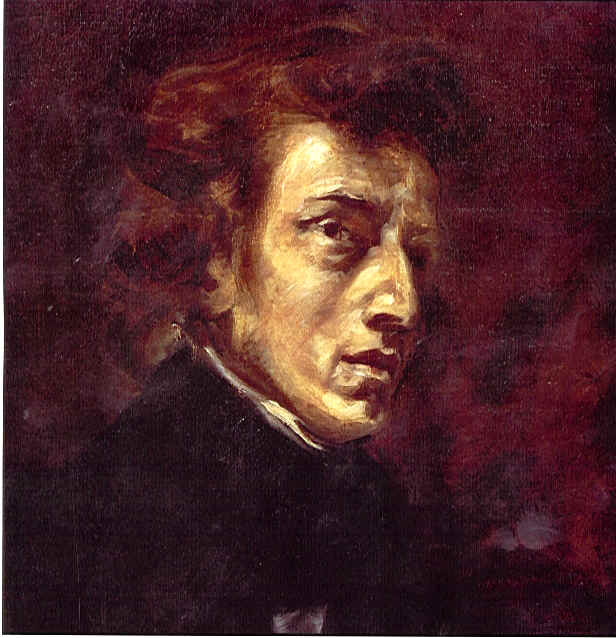
Auteur de préludes, études, polonaises, nocturnes et sonates sans la moindre référence extramusicale, Chopin fut le premier à utiliser dans un contexte instrumental le terme de "ballade" qui s'applique habituellement à une page vocale de caractère lyrique ou narratif.
Chopin confia à Schumann avoir été stimulé par la lecture de certains passages du poète polonais Adam Mickiewicz. Il faut sans doute voir dans cette confidence la reconnaissance d'une aire d'appartenance, d'une affinité poétique et culturelle plus que la volonté de traduire en langage musical l'œuvre du poète. On se souviendra, à ce propos, que Chopin appréciait peu la musique à programme...
Les raisons qui poussèrent le compositeur à choisir ce titre de "ballade" sont donc plutôt à chercher dans la continuité d'un flux lyrique et narratif de nature purement musicale.
La forme, quant à elle, répond à une logique dramatique que l'on ne saurait réduire aux schémas traditionnels : entre forme sonate et variations, Chopin évite soigneusement de s'enfermer dans une forme figée qui pourrait provoquer une chute de tension inadaptée au parcours émotionnel conçu généralement en grands arcs de fébrile continuité.
La composition des quatre Ballades s'échelonne sur une douzaine d'années. Par l'intensité de leur accent mélodique et par la richesse de leur écriture harmonique, elles figurent parmi les œuvres les plus accomplies du musicien.
F. CHOPIN : Ballade n°1 en sol mineur, Op. 23.
Achevée à Paris en 1835, cette Ballade n°1 compte parmi les œuvres que Chopin préférait. Cela nous est confirmé par Schumann qui écrit en septembre 1836 après avoir rencontré Chopin à Leipzig : " De Chopin, j'ai une récente Ballade en sol mineur. Elle me semble géniale et je lui ai dit qu'elle était celle des ses œuvres qui me plaisait le plus. Après un assez long silence, il me dit tout à coup : "Cela me fait un grand plaisir, car c'est aussi celle que je préfère".
La Ballade en sol mineur est un immense poème plein de passion, d'émotion et de mélancolie presque douloureuse. Après une brève introduction à l'unisson, la mélodie du premier thème s'élève comme une plainte sur un rythme de valse presque improvisé. Une cadence fugitive et virtuose avec ses belliqueuses sonneries de basses mène vers le second thème, suave et caressant. Il est suivi d'un court divertissement, instant de joie fugace précédant le moment de passion des mesures à venir. Dans ces mesures, le retour des thèmes s'affirme dans une extraordinaire envolée qui éclate jusqu'à la progression de gammes chromatiques fortissimo.
Un nouvel épisode de divertissement, d'une virtuosité débordante, nous conduit à la réapparition du second thème dans toute son ampleur. Le thème initial s'affirme ensuite une dernière fois, dans un climat de passion quasi pathétique, et s'enchaine Presto con fuoco avec la tumultueuse coda à deux temps. Dans l'effervescence d'une exceptionnelle virtuosité, tout s'accélère pour aboutir sur un éblouissant dessin chromatique d'octaves qui s'achève en deux longs accords sonores.
F. CHOPIN : Ballade n°2 en fa majeur, Op. 38.
Commencée dès 1836, cette Ballade n°2 fut achevée dans sa version définitive en janvier 1839 lors du séjour catastrophique de Chopin et George Sand à Majorque. L'œuvre est dédiée à R. Schumann mais il ne faut voir dans cette dédicace qu'une formalité de courtoisie, le remerciement de la dédicace des Kreisleriana op. 16. On sait en effet que Chopin resta totalement fermé à l'art de Schumann dont il n'aima jamais la musique. Schumann, quant à lui, admira profondément cette Ballade qu'il qualifia de "morceau remarquable"...
La Ballade en fa majeur est une succession d'épisodes de douceur et de force. Quelques notes, résonnant comme le tintement d'une cloche, introduisent le premier thème qui s'épanouit et se répète dans la grande quiétude de son rythme apaisant. Le deuxième épisode, épisode de force Presto con fueco, s'enchaine immédiatement dans un déferlement de doubles croches. Ces rafales de traits arpégés, d'octaves puissantes et de gammes ascendantes s'apaisent peu à peu pour laisser la place, dans un contraste saisissant, au premier thème. Omniprésent, ce thème se répète inlassablement dans le chant de la basse puis se module pour éclater en octaves sous de forts accords qui progressent par degrés chromatiques. Ce calme apparent mais pathétique précède la tempête : déjà le déferlement sonore du Presto con fueco surgit de nouveau et conduit dans un dessin de trilles prolongés à la coda Agitato. L'emportement, le déchaînement atteignent ici au paroxysme de la virtuosité et de l'explosion sonore. Un accord puissant annonce la courte conclusion. C'est dans le charme et la douceur des mesures initiales que se termine cette Deuxième Ballade.
F. CHOPIN : Ballade n°3 en la bémol majeur, Op. 47.
Publiée en 1841 et interprétée en première audition par Chopin en février 1842 chez Pleyel, la Troisième Ballade est considérée comme une des pages les plus originales du compositeur.
Dans la Gazette musicale, le critique Maurice Bourges écrivait en 1842 : "C'est une des compositions les plus achevées de M. Chopin. Sa flexible imagination s'y est répandue avec une magnificence peu commune. Il règne, dans l'heureux enchaînement de ces périodes aussi harmonieuses que chantantes, une animation chaleureuse, une rare vitalité."
Dans les mesures initiales, le premier thème est chanté par deux voix distinctes, comme un dialogue entre la partie supérieure et la basse. Cette tendre confidence s'anime cependant peu à peu dans un climat fiévreux qui explose sur de rapides arpèges divergents. Le premier thème réapparaît furtivement, puis se calme sur de longs accords tenus.
De joyeux sautillements d'octaves annoncent le second thème, le plus important de l'œuvre. Il reviendra en effet régulièrement, souvent soutenu par des ondulations de doubles croches. Un nouveau motif apparaît qui se répète avec de plus en plus de force, puis en une succession d'accords puissants et arpégés sur une triple pédale d'ut. Par leurs doubles croches volubiles, les quelques mesures suivantes semblent présager un moment de joie. Mais dans son obstination, la main gauche qui les soutient a quelque chose d'inquiet et d'haletant. Le second thème revient, d'abord augmenté de doubles croches, puis dans son énoncé premier grâce auquel Chopin peu à peu va changer de tonalité, de décor. Le thème chante sur la montée chromatique de doubles croches légères de la basse. Tout cet épisode est plein d'un bouillonnement continu d'effets et de figures variées qui passent d'une main à l'autre. Deux descentes chromatiques annoncent le retour du premier thème. Celui-ci évolue dans un étrange climat modulant très éloigné de celui des premières mesures. L'œuvre s'anime dans un grondement d'octaves qui balaient le clavier. Chopin conclut Più mosso, par l'épisode joyeux déjà entendu après l'énoncé du second thème.
F. CHOPIN : Ballade n°4 en fa mineur, Op. 52.
Composée en 1842, la Ballade n°4 est dédiée à la Baronne Charlotte de Rotschild, une des élèves préférées de Chopin. Chef-d'œuvre extraordinaire par son inspiration et son éloquence, par l'originalité de ses motifs et la richesse de son harmonie, c'est une page pathétique, tantôt passionnée, tantôt triste voire suppliante. On peut y voir, comme Alfred Cortot "une somptuosité harmonique, un raffinement d'écriture très significatif d'une nouvelle orientation su style de Chopin. A n'en pas douter, s'il eût vécu, c'est dans un caractère précurseur de notre impressionnisme musical qu'il eût écrit les chefs-d'œuvre à venir"...
Cette dernière Ballade s'ouvre par sept mesures d'introduction sur un motif d'un lyrisme tendre et nostalgique qui reparaîtra au centre de l'œuvre.
Le premier thème a le caractère expressif d'un thème de Nocturne, égayé par un petit dessin de croches enjouées. De longs accords plaqués sur de puissantes octaves, qui semblent se balancer, conduisent à la réexposition du thème, transformé dans sa ligne mélodique et agrémenté d'une gracieuse suite de tierces parallèles. Un brillant Accelerando mène au second thème, exposé sur son rythme calme de barcarolle. Puis tout s'anime dans un brio étourdissant, qui s'apaisera sur le retour du motif de l'introduction.
Un surprenant canon à deux puis à trois voix reprend ensuite les éléments du premier thème qui prennent un caractère inquiet et tourmenté, mais se développent et se transforment aussitôt en joyeux triolets tourbillonnants.
Le second thème participe à cette explosion sonore qui s'épanouit somptueusement jusqu'à trois grands accords fortissimo, interrogatifs. A cette interrogation répondent, hésitants, cinq accords longs et clairs. Ils paraissent marquer le départ de la coda dans un tumulte plein de vitalité. La Ballade qui avait commencé dans le rêve, s'achève dans un chaleureux enthousiasme.
F. CHOPIN : Polonaise "Héroïque" en la bémol majeur Op. 53
Forme première de la création de Chopin, la Polonaise couvre à peu près toute sa carrière, entre 1817 époque de la publication (Chopin avait 7 ans) à Varsovie d'une Polonaise en sol mineur, et 1846, année de la composition de la Polonaise-Fantaisie Op. 61.
La vogue que connut la Polonaise au 19ème siècle est en grande partie liée à la prise de conscience du drame polonais en Europe dans les années 1830. Comme le souligne Liszt, "les Polonaises de Chopin, tour à tour tragiques, sombres ou lumineuses, traduisent la résistance désespérée d'un peuple agressé et menacé".
La célèbre Polonaise Op. 53 dite Polonaise Héroïque est composée en 1843 et dédiée au banquier français Auguste Léo. C'est une page véhémente et solennelle, faite de violences rythmiques et de nostalgie.
De puissantes montées chromatiques servent d'introduction, puis la danse pathétique s'élance en des dessins mélodiques et rythmiques extrêmement variés. Tout se calme brièvement puis une cadence mène à un nouvel épisode brillant, épisode populaire entre tous. Ses répétitions de doubles croches obstinées (redoutables pour le poignet du pianiste...) sont comme l'affirmation de l'intensité première de l'œuvre.
F. CHOPIN : Trio Op. 8 en sol mineur
Si Chopin a confié l'essentiel de son inspiration au piano seul, celui-ci est dans quelques œuvres de jeunesse associé à l'orchestre ou à la voix. Dans la musique de chambre qui n'occupe qu'une place très marginale dans son œuvre, le piano se voit parfois concurrencé par un instrument favori : le violoncelle. En dehors du piano, ce fut en effet le seul instrument pour lequel Chopin montra un intérêt réel et suivi.
La composition de ce trio Op. 8 débute en 1828 (Chopin est alors âgé de 18 ans) et est interrompue par le voyage de Chopin à Berlin. Le Trio ne sera achevé et publié qu'en 1833. L'accueil du public est bon : à Leipzig, Schumann se déclare enchanté par cette œuvre et même le critique berlinois Rellstab (qui par la suite manifestera une incompréhension totale de l' œuvre de Chopin) émet un jugement positif.
On remarquera dans ce Trio d'un caractère plutôt sombre de nombreuses innovations formelles : Chopin prend visiblement ses distances avec les schémas classiques.
A. PIAZZOLLA : Les Quatres Saisons de Buenos Aires
Né à Mar del Plata de parents d'origine italienne, Astor Piazzolla émigre à New York avec sa famille alors qu'il n'a que quatre ans. Dès huit ans, il joue du bandonéon. Adolescent, il retourne en Argentine et, en quelques années, obtient un poste dans le célèbre orchestre de tango d'Aníbal Troilo. Rapidement ennuyé par un genre qui, selon lui, connait une impasse, dans ses temps libres, il se met à cultiver son intérêt de longue date pour la musique classique en composant un corpus de musique "sérieuse" considérable. En 1954, prévoyant de faire carrière en musique classique, il se rend en France pour étudier avec la plus célèbre pédagogue en composition de l'époque, Nadia Boulanger. Cette rencontre changera sa vie – et l'histoire du tango – à jamais.
Boulanger considère la musique de Piazzolla comme bien faite et y reconnait l'influence de Ravel, Stravinski et Bartók. Pourtant, selon elle, il y manque l'esprit. Quand elle apprend que Piazzolla compose et arrange des tangos pour gagner sa vie (avec une certaine honte), elle lui demande de lui en jouer un. À contrecœur, il s'exécute. Boulanger prend alors ses mains dans les siennes et lui dit : "Astor, c'est magnifique. Voilà le vrai Piazzolla ! Ne le quitte jamais !"
Considérant ce moment comme "la plus grande révélation de sa vie", Piazzolla retourne en Argentine pour y fonder son célèbre Quintette (bandonéon, violon, piano, guitare électrique, contrebasse), véhicule-clé de son nuevo tango, un nouveau style qui intègre les harmonies dissonantes et les polyrythmes des maîtres classiques du XXe siècle. Ce faisant, il fait passer le tango du plancher de danse à la salle de concert
La vision du tango de Piazzolla devait cependant rencontrer une résistance féroce de la part des traditionnalistes. Après un concert, un auditeur lui demanda en ricanant : " Maestro, pourquoi ne jouez-vous pas un tango? " La question devait le hanter pendant toute sa carrière. Dans son autobiographie, il soutient même avoir été battu une fois dans les rues par un membre de la vieille garde du tango contrarié.
Parmi les nombreuses pièces écrites par Piazzolla pour son Quintette, on retrouve Las cuatro estaciones porteñas. L’œuvre est un hommage à sa ville natale, Buenos Aires, et à ses habitants qui, aujourd’hui encore et avec fierté, s’intitulent eux-mêmes porteños - littéralement, habitants d’un port.
Les quatre pièces sont pleines d'énergie, de dissonances grinçantes et de rythmique percussive. Des interludes lents offrent des sections contrastantes de lyrisme nostalgique. Le schéma vif-lent-vif (sauf celui d'Invernio porteño (hiver), renversé) est peut-être le clin d'œil le plus significatif aux Quatre Saisons de Vivaldi, œuvre de son célèbre prédécesseur. Sinon, les Saisons de Piazzolla, non conçues comme un tout, ont peu à voir avec le style ou le concept de Vivaldi. Alors que les Saisons de Vivaldi sont pastorales et littérales (chiens aboyant, oiseaux gazouillant et orages se préparant), celles de Piazzolla sont urbaines, liées à une ville en particulier et dépeignent l'essence de chaque saison plutôt que d'en traduire littéralement les sonorités. Piazzolla écrivit Verano porteño (été) d'abord, en 1965, et compléta les autres segments de 1965 à 1969.